Toute règle finit par rompre
Et révéler la véritable nature de votre jeu.
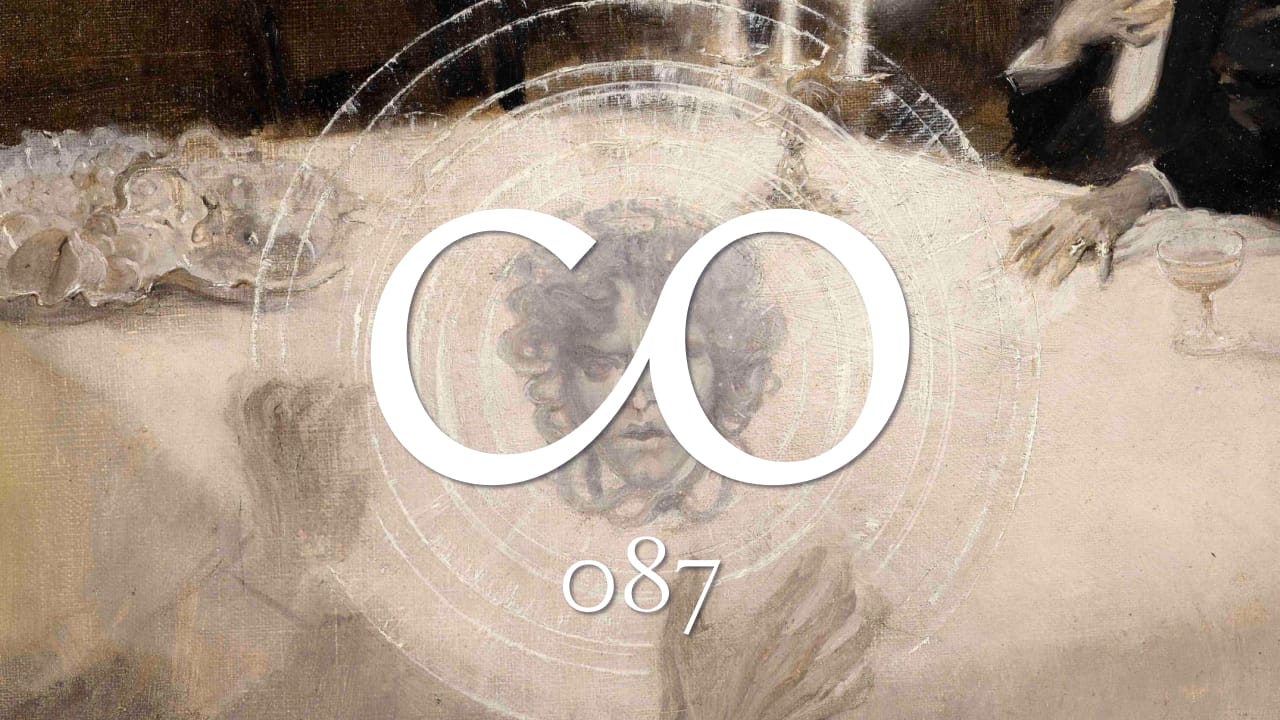
Une question qui m’a été posée au club m’a fait rouvrir Fin d’un jeu, de Cortazár, qui contient deux de mes nouvelles préférées, « Continuité des parcs » et « Axolotl », ainsi que de très belles images de bayou au clair de lune dans une troisième, « Récit sur un fond d’eau ». De cette dernière, j’avais à peu près tout oublié, si ce n’est justement ces images, poisseuses et macabres, qui surnagent comme les fragments du rêve qu’essaye de se rappeler le narrateur, comme le visage de ce noyé qui passe au fil de l’eau, « la lune agenouillée sur sa poitrine », dont la vision réveille le narrateur avant qu’il ne puisse en arracher un souvenir. Le corps et le visage qui flotte par-dessus comme une feuille molle qui s’y colle et s’en décolle selon l’agitation des mains du fleuve « glissant sur la boue jaune », qui le palpent et le bercent et le retournent, le corps et le visage sont peut-être les siens, peut-être ceux d’un autre, et le rêve la prémonition d’un meurtre.
« Axolotl » commence par la révélation de sa fin : « Et maintenant je suis un axolotl. » Le narrateur a échangé son corps avec celui de l’amphibien qu’il observait jour après jour dans un aquarium du Jardin des Plantes. À force de se perdre, comme hypnotisé, au fond des petits yeux sans paupières, il a fini par ne plus pouvoir remonter de l’obscurité silencieuse que cachait ce regard buvard de sa conscience. Il est désormais « enterré vivant dans un axolotl ».
Je finis par voir dans les axolotls une métamorphose qui n’arrivait pas à renoncer tout à fait à une mystérieuse humanité. Je les imaginais conscients, esclaves de leur corps, condamnés indéfiniment à un silence abyssal, à une méditation désespérée. Leur regard aveugle, le petit disque d’or inexpressif – et cependant terriblement lucide – me pénétrait comme un message : « Sauve-nous, sauve-nous. »
Il n’est pas impossible qu’il ait pris la place d’un autre humain, prisonnier avant lui de ce corps de salamandre.
« Continuité des parcs », sur laquelle portait la question qui m’a été posée, est peut-être ma préférée des trois et aussi la plus courte, elle ne fait pas même 600 mots.
Dans cette histoire, un personnage lit un roman dans le salon de sa propriété, sans se douter qu’il lit bien malgré lui le récit de son propre meurtre par l’amant de sa femme. La question portait sur l’absence manifeste de transformation qui dans cette nouvelle semble violer la définition même d’une histoire, censée raconter le changement significatif et irréversible du protagoniste. Qui est le protagoniste de cette nouvelle ? Sans doute pas le personnage qui lit – celui-ci serait plutôt, un peu comme dans La Jetée, le narrateur-témoin de sa propre mort. S’il fallait chercher un ou des protagonistes, je dirais qu’il s’agit de la femme et de son amant. Leur transformation en assassins a eu lieu en quelque sorte avant le début de l’histoire (le meurtre est « décidé depuis toujours »), même si elle n’est effective qu’à la fin (et encore, on s’arrête avant le coup de poignard). De cette transformation, l’essentiel nous est occulté, car ce qu’écrit Cortazár est moins l’histoire d’un meurtre que la transformation d’un cadre (et de la perception qu’on en a), ou le débordement d’une fiction dans son récit cadre – ce que je lis se met soudain à me raconter – et le vertige ontologique qui en résulte. Le cadre scintille, miroite, devient poreux, et on bascule d’un monde à l’autre, d’un plan de l’existence à un autre, alors que les deux ne devraient jamais communiquer. C’est ce très lynchien ruban de Möbius qui signe le bizarre de la Continuité des parcs et prouve qu’en l’absence de transformation du personnage, une certaine forme de progression suffit.
Une règle n’est pas une contrainte arbitraire que nous choisissons comme un handicap pour compenser l’insolence de notre talent (même si certains insensés le font très bien), mais la condensation d’une méditation sur la nature même du jeu auquel nous jouons. Une hypothèse à tester en même temps qu’une déclaration : la littérature, c’est ça.
Mais toute règle finit par rompre, y compris celle de la transformation du protagoniste – il suffit de la soumettre à d’autres contraintes suffisamment fortes ; la concision en est une. 500 mots ne suffisent pas (et 600 pas plus que 500) à raconter la transformation d’un personnage (ou l’échec de cette transformation). Au mieux peut-on en avoir un aperçu.
Dans des conditions suffisamment extrêmes, ne survit que la poésie, ou la littérature réduite à ses constituants essentiels, une image et un rythme s’enlaçant autour d’une sensation pour la rendre perceptible au lecteur. Qu’est-ce qui pour vous persiste au bord de l’extinction, sans quoi ce ne serait plus de la littérature ?
Vous avez une question ? Posez-la moi par retour d’email.
Vous voulez écrire davantage et mieux ? Adhérez à notre club d’écriture.
Bloqué(e) dans l’écriture d’un roman ? Sollicitez mon aide.

